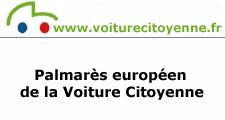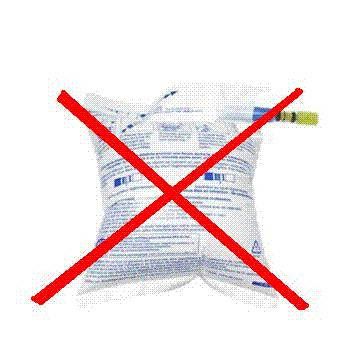Les actualités
ImprimerEconomie de la sécurité routière – Année 2009
Un enjeu économique considérable et méconnu,
Nous savons tous que l'insécurité routière entraîne beaucoup de souffrance et des milliers de victimes. En 2009 il y a eu encore pour la France métropolitaine 72315 accidents corporels, plus de 90000 blessés et 4273 tués .
Nous savons moins que l'insécurité routière entraîne un gâchis économique considérable. En 2009, 23,7 milliards d'euros sont partis en fumée pour soigner les blessés, dédommager les victimes et réparer les dégâts matériels des accidents. (Réf 1) .)
Impact économique du sursaut de 2002
L'année 2002 a marqué un tournant dans le combat contre l'insécurité routière avec la décision prise au plus haut niveau de l'Etat d'en faire une priorité nationale.
Cette volonté, largement relayée par les médias, s'est traduite par une loi de « lutte contre la violence routière » et par des mesures dont la plus spectaculaire a été la mise en place d'un système de contrôles-sanctions automatisé.
Le budget de l'Etat affecté à la sécurité routière dans les divers ministères est ainsi passé de 1454 millions d'euros en 2001 à 1629 millions en 2003 pour atteindre 2539 millions en 2009. (Réf 2) .
Cet effort supplémentaire, bien ciblé sur les actions les plus efficaces (renforcement des contrôles routiers, achat des radars automatiques et multiplication des messages de prévention), a eu un impact considérable sur la sécurité avec une baisse sans précédent, dès l'année 2003, du nombre des tués et des blessés. Cette baisse s'est poursuivie les années suivantes, à un rythme certes plus lent. Au total, entre 2001 et 2009, le nombre des accidents corporels a chuté de 38% et celui des tués de 48%.
Le coût de l'insécurité routière a suivi cette évolution favorable. Il est passé de 27,8 milliards d'euros en 2001 (33,8 valeur 2009) à 23,7 milliards en 2009 alors que les coûts unitaires pour les blessés et la réparation des dégâts matériels augmentaient dans la même période de 24,5 et 18,5 %.
L'effort additionnel en faveur de la sécurité routière de 1100 millions d'euros en 2009 par rapport à 2001, a donc permis à la collectivité nationale de faire une économie annuelle de 10,1 milliards d'euros, par rapport à 2001, en monnaie constante valeur 2009. Quelles entreprises, quelles banques oseraient rêver d'un tel retour sur investissement ?
De plus, la réduction du nombre des accidents et des blessés de la route a apporté une contribution positive au désengorgement des urgences dans les hôpitaux, a rendu moins aiguë la pénurie d'infirmières. Elle libère maintenant, pour d'autres missions, les policiers et les gendarmes moins affairés autour des accidents.
Enfin, la modération des vitesses, a entraîné une réduction de la consommation de carburant .
Evolution du montant des primes d'assurance
Devant la baisse du nombre de sinistres recensés entre 2001 et 2009 (-30% d'accidents corporels et -44% de tués) on pouvait s'attendre à une forte baisse du montant des primes d'assurance. Or la baisse sur les primes de base (avant application du bonus/malus) n'a été que de 5 à 10 % variable selon les compagnies d'assurance. La fédération française des sociétés d'assurance (FFSA) justifie cette timidité dans les baisses pour deux raisons :
- d'une part, « la diminution du nombre de sinistres ne compense pas la hausse de la charge par sinistre ». Celle-ci, beaucoup plus forte que l'inflation serait entre 2001 et 2009, d'après les assurances de l'ordre de 22 à 28% pour les accidents corporels et de 16 à 20% pour les accidents matériels alors que l'inflation générale dans la même période n'a été que de 12% (INSEE).
- d'autre part, le nombre des accidents matériels a baissé moins fortement que celui des accidents corporels .
En combinant la baisse constatée sur les primes de base, la non répercussion des hausses des coûts des sinistres sur celles-ci et l'augmentation du nombre des bonus, le gain pour chaque usager est de l'ordre de 25%. Or 25 % de gain sur une prime moyenne de 500 euros, cela représente environ 125 euros d'économie annuelle pour chaque usager.
Nota : Bien comprendre que ces chiffres sont des évaluations qui permettent de fixer des ordres de grandeur et non le résultat d'un analyse comptable précise. Le manque de transparence des assurances ne permet pas de faire une analyse plus fine.
Bilan économique du système de contrôles-sanctions.
Nous ne disposons pas de toutes les données pour établir un bilan complet du système, mais les chiffres publiés dans les bilans annuels de la sécurité routière (Réf 1) permettent de comparer les ordres de grandeur en jeu.
Au chapitre des dépenses du système, il y a celles consacrées à la sécurité routière du Ministère de la Défense (gendarmerie), de l'Intérieur (police) et de la Justice soit au total 1700 millions d'euros en 2009 .
Au chapitre des recettes, il y a le montant des amendes soit environ 800 millions d'euros . Elles sont loin de couvrir les dépenses nécessaires à leur constatation et à leur recouvrement.
En ce qui concerne les radars automatiques, l'Etat a installé 2300 radars à fin 2008 pour un montant global de environ 230 millions d'euros soit environ 100 000 euros par radar Ceux-ci ont permis de relever 7 812 000 infractions à la vitesse en 2008 pour un montant approximatif de 500 millions d'euros suffisant pour couvrir assez largement le prix d'achat et d'installation des radars mais pas l'infrastructure policière et juridique nécessaire à leur fonctionnement.
Conclusions
Trop souvent les commentateurs ont limité l'approche économique de la sécurité routière aux seules recettes « indues » faites par l'Etat sur le dos des usagers par le biais des amendes. Qui n'a pas lu dans la presse ou entendu à la radio les vindictes sur les radars « pompes à fric ». C'est vraiment voir l'économie de la sécurité routière par le petit bout de la lorgnette. C'est tout ignorer des coûts énormes entraînés par l'insécurité routière et des dépenses supportées par l'Etat pour réduire celle-ci..
Le bilan économique de la politique récente de sécurité routière a une tout autre dimension. Ce n'est plus en centaines de millions d'euros qu'il faut compter au chapitre de l'actif de cette politique mais en milliards. Et les bénéficiaires, ce ne sont pas les caisses de l'Etat mais la collectivité nationale toute entière et chaque usager en particulier par le biais de la baisse des primes d'assurance et de la non répercussion des hausses des charges sur celles-ci. Avec une économie moyenne de 125 euros par prime d'assurance, même le contrevenant pénalisé d'une contravention de 90 euros dans l'année est encore « gagnant ».
Dans toute la sphère économique, la prévention routière est de très loin l'activité la plus rentable. Un euro investit dans la prévention génère dans l'année plusieurs euros de bénéfices sous-forme de réduction des dépenses liées aux dégâts des accidents, sans oublier bien sûr la diminution des souffrances.
Remarques et commentaires
Coût de l'insécurité routière : Source : Réf 1 La sécurité routière en France -Bilan de l'année 2009 - Observatoire National Interministériel de Sécurité Routière (ONISR) (Après correction)
Coût de l'insécurité routière en 2009 : 23,7 milliards d'euros dont 10,7 pour les accidents corporels et 13,04 pour les accidents matériels.
Bases de calcul : Coûts moyens pour un tué : 1 254474 € ; pour un blessé hospitalisé : 135 526 € ; pour un blessé léger : 5 421 € ; 6 526 € pour les dégâts matériels. (Environ 20 fois plus d'accidents matériels que d'accidents corporels)
Plus de la moitié de cette somme est couverte par les assurances (et donc par contre coup par les usagers), l'autre partie correspond soit à des coûts non marchands indirects comme la perte d'activité des victimes, soit à des dépenses supportées par la sécurité sociale ou restant à la charge directe des usagers (franchise ou assurés au tiers).
Budget de la sécurité routière. Le Ministère des Finances publie depuis 2001, en marge de la loi des finances un rapport intitulé « L'effort de la nation en faveur de la sécurité routière » Réf 2 . Cet effort, qui comprend les contributions de tous les ministères concernés par la sécurité routière, s'est élevé en 2009 à 2539 millions d'euros avec la répartition suivante entre les ministères : développement durable (sécurité routière, routes etc.) 928 M€ ; Défense (gendarmerie) 791 M€ ; Intérieur (police) 564 M€ ; Justice 159 M€ ; Education nationale : 61 M€ ; autres 19 M€. Ces chiffres sont publiés dans les bilans annuels de l'ONISR (Réf 1 ci-dessus)
Pour être complet, il conviendrait d'ajouter les contributions des collectivités locales pour l'amélioration de la sécurité des routes et la participation des polices municipales à la sécurité routière. Nous n'avons pas de données sur cette contribution mais on peut risquer un montant d'environ 2 milliards d'euros ce qui porterait à peu près à 4,6 milliards d'euros l'effort total de la nation, bien loin encore du coût de l'insécurité routière.
d'après les bilans annuels de l'ONISR. A noter que les compagnies d'assurances affichent des taux d'augmentation plus élevés.
A ce sujet on peut noter que les premières limitations de vitesse avaient été décrétées en 1974 dans un souci de réduction de la consommation de carburant suite au premier choc pétrolier. Elles avaient eu comme conséquence annexe positive une réduction du nombre des accidents. Retour des choses, c'est maintenant le souci de réduire l'insécurité routière qui entraîne une baisse de la consommation.
Si l'on en croit les bilans annuels de l'ONISR (Réf 1), le coût total des accidents matériels aurait même augmenté entre 2001 et 2007, passant de 12,5 milliards d'euros en 2001 à 13,75 milliards en 2007 pour redescendre ensuite à 11,4 milliards en 2008 puis remonté à 13,04 milliards en 2009. La baisse du nombre des accidents matériels étant trop faible pour compenser l'augmentation des coûts unitaires des sinistres matériels. Ce résultat laisse perplexe et ne rend pas compte du fait que la profession des carrossiers a constaté une forte baisse de son chiffre d'affaires..
En 2009, 20,8 millions de contraventions ont été dressées, dont 6,6 pour le stationnement, 9,9 contraventions à la vitesse, 0,38 pour alcoolémie.